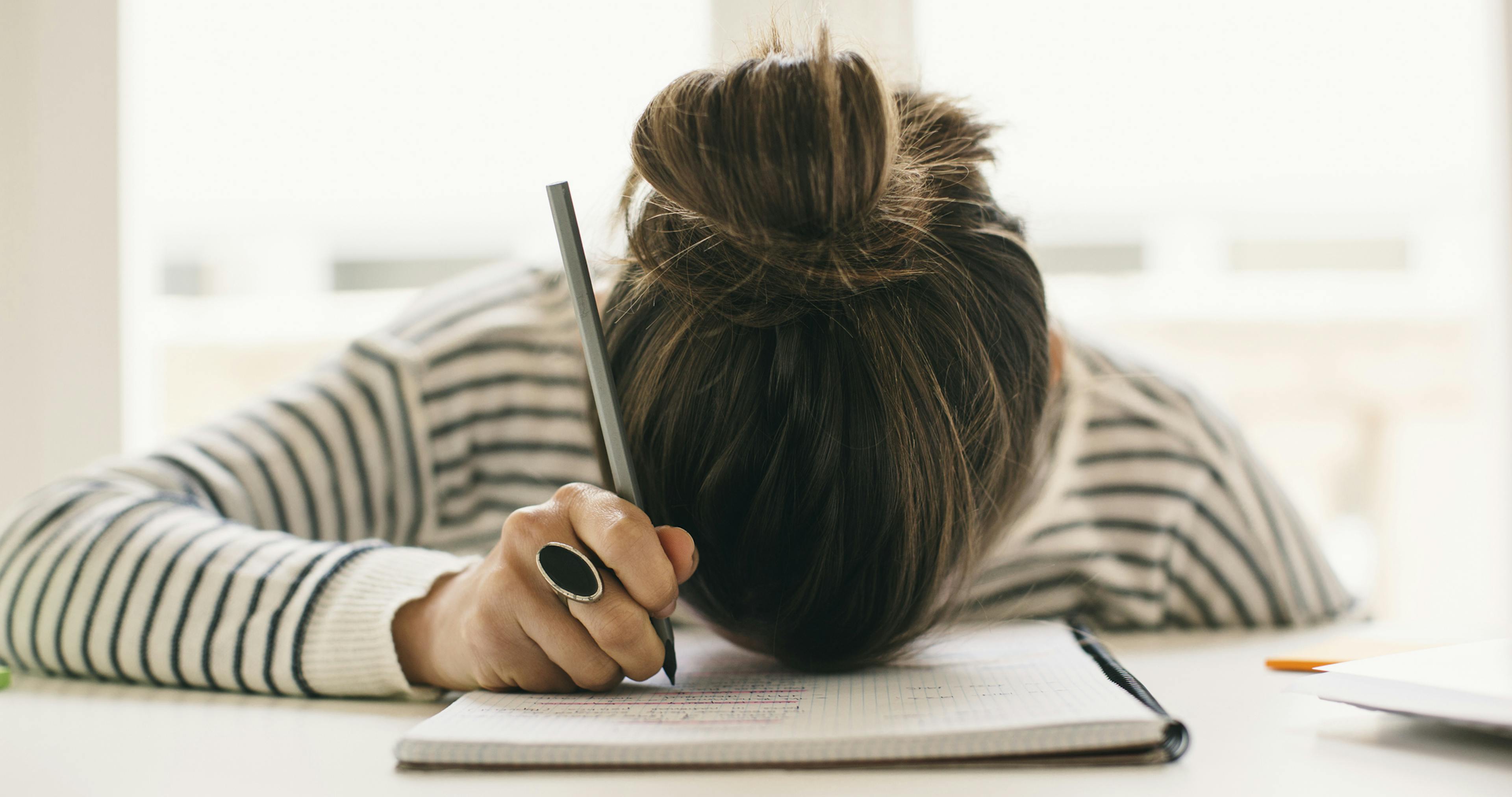Hypersensibilité et hyperémotivité : quelles différences ?
L’hypersensibilité et l’hyperémotivité sont des caractéristiques émotionnelles proches, qui entraînent des réactions parfois intenses et des comportements disproportionnés pouvant affecter la vie personnelle et professionnelle. De façon ambivalente, elles peuvent aussi représenter une forme de richesse. Quelques clés pour mieux les comprendre et en tirer parti…
Qu’est-ce que l’hypersensibilité ?
L’hypersensibilité n’est pas un trouble psychologique, mais un trait de la personnalité. La personne hypersensible perçoit de façon plus intense les signaux émis par son environnement. L’hypersensibilité englobe différents aspects et peut s’exprimer dans un ou plusieurs de ces registres :
- L’hypersensibilité sensorielle, qui se traduit par des réactions exacerbées aux bruits, à la lumière, aux textures, aux saveurs... Par exemple, une personne hypersensible peut se sentir mal dans un open space, où les sollicitations sensorielles peuvent être nombreuses (éclairage, forte fréquentation, bruits ambiants…).
- L’hypersensibilité émotionnelle, qui se manifeste par des émotions ressenties de façon très intense et une empathie particulièrement marquée. La personne hypersensible « se chargeant » des émotions des autres, elle accroît souvent sa propre vulnérabilité. Elle peut se sentir épuisée, éprouver un sentiment de culpabilité et avoir souvent envie de pleurer.
- L’hypersensibilité environnementale, qui se révèle souvent par des difficultés à appréhender les changements, les imprévus ou les états de tensions de stress. Les personnes hypersensibles fuient le conflit et présentent des difficultés dans la gestion du stress. Elles sont aussi profondément touchées par les jugements et les critiques, qui peuvent entraîner chez elles un mal-être profond alors que pour d’autres, il ne s’agira que d’une contrariété passagère ou d’une simple remarque.
- L’hypersensibilité cognitive, qui se caractérise par une propension exacerbée à analyser, à imaginer et à échafauder des scénarii l’amenant à s’inquiéter trop facilement. Les hypersensibles peuvent ressentir un besoin de solitude pour faire une pause et « se recharger ».
Le saviez-vous ?
L’hypersensibilité est une notion récente. Ce champ de la psychologie a été ouvert en 1990, par Elaine Aron, une psychiatre et chercheuse en psychologie d’origine américaine. Elle a mis au point un test afin de déterminer l’hypersensibilité et a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont « Hypersensibles mieux se comprendre pour s'accepter » et « Aimer quand on est hypersensible ».

Le cerveau des hypersensibles est-il différent ?
Non, le système nerveux central d’une personne hypersensible est anatomiquement identique à celui d’une personne qui ne l’est pas. En revanche, il fonctionne de façon un peu différente. De récentes recherches montrent qu’un gène transporteur de sérotonine pourrait influencer la perception des stimuli (1). La neuro-imagerie a mis en évidence que les sujets porteurs de cette variation génétique présentaient une hyperactivité de l'amygdale, une région du cerveau impliquée dans le traitement des émotions.
Le saviez-vous ?
L’hypersensibilité concernerait jusqu’à 30 % (2) des personnes dans le monde.

Qu’est-ce que l’hyperémotivité ?
L’hyperémotivité est l’une des dimensions de l’hypersensibilité. Alors que l’hypersensibilité inclut une forte composante émotionnelle parmi d’autres (sensorielle, physique), l’hyperémotivité est principalement émotionnelle avec des manifestations comportementales fréquentes. L’hyperémotivité correspond à un ressenti intense des émotions (peur, colère, tristesse, dégoût, surprise, joie) et à la difficulté pour les maîtriser et les exprimer de façon adaptée. Cette démesure émotionnelle peut s’exprimer de deux façons : l’intériorisation ou l’extériorisation. Au cours de l’intériorisation, la personne hyperémotive peut avoir du mal à exprimer ses émotions, paraître réservée, froide, introvertie et également manifester un goût pour l’isolement. Concernant l’extériorisation, le sujet peut sembler impulsif, colérique et vivre certaines situations de façon exagérée avec une propension dramatique.
Hypersensibilité et hyperémotivité : des vulnérabilités à convertir en atouts
Les hypersensibles comme les hyperémotifs sont débordés par un afflux d’informations émotionnelles et affectives. Leur difficulté ne réside pas dans le nombre de stimulus qu’ils perçoivent, mais dans leur capacité à les maîtriser, à les interpréter et à les hiérarchiser.
Lorsque l’hypersensibilité ou l’hyperémotivité est mal vécue et entrave la vie personnelle ou professionnelle, il est souvent bénéfique de se tourner vers des thérapies encadrées par un psychothérapeute (psychiatre ou psychologue), telles que les thérapies interpersonnelles (TIP) ou les thérapies cognitivo-comportementales (TCC).
En revanche, lorsque les processus mentaux parviennent à se réguler, l’hypersensibilité et l’hyperémotivité deviennent des atouts, grâce à une empathie plus forte et une perception plus fine des détails.
Des techniques de développement personnel sont aussi une ressource intéressante pour mieux apprendre à gérer l’hypersensibilité ou l’hyperémotivité au quotidien. Par exemple, le yoga, la méditation et la sophrologie peuvent apporter des solutions pour se recentrer sur ses ressentis, apprivoiser ses émotions et réduire l’anxiété ou le stress.
L’homéopathie pour mieux vivre l’hypersensibilité et l’hyperémotivité
L’hypersensibilité et l’hyperémotivité ne sont pas du registre de la pathologie mais des caractéristiques émotionnelles que le praticien peut accompagner par une prescription adaptée pour en diminuer l’intensité et la répétitivité, qui altérer la qualité de la vie personnelle, professionnelle ainsi que les relations interpersonnelles.
Les traitements homéopathiques peuvent apporter une aide en parallèle d’une prise en charge psychothérapeutique. Ils sont sans effets secondaires connus et sont compatibles avec d’autres traitements médicamenteux en cours.
Lors de la consultation, le médecin homéopathe consacrera une attention particulière à la sensibilité et la personnalité de son patient, et aux contextes dans lesquels il réagit de façon exacerbée. Il prendra aussi en compte son cadre familial, ainsi que les événements et les difficultés auxquels il peut être confronté. A l’issue de cet entretien, il pourra établir une prescription personnalisée, ciblant précisément les manifestations émotionnelles psychiques et physiques de son patient.
(1) https://www.qmul.ac.uk/media/news/2020/se/study-in-twins-finds-our-sensitivity-is-partly-in-our-genes.html - consulté en octobre 2025
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092656619300583?via%3Dihub – consulté en octobre 2025
A lire également sur la même thématique